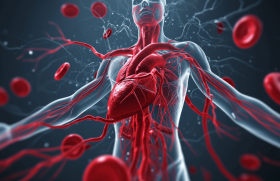Publié le 12 mai 2025Lecture 6 min
Le point sur l’essentiel de 2024 en imagerie cardiovasculaire
Anne BERNARD, service de cardiologie, CHU de Tours ; Inserm U1327 ISCHEMIA « Membrane signaling and inflammation in reperfusion injuries », universite de Tours

Cette revue présente dix études majeures en imagerie cardiovasculaire publiées en 2024, sélectionnées pour leur impact sur la compréhension des pathologies cardiovasculaires et notre pratique clinique.
Analyse des plaques d’athérosclérose par scanner
Cette étude a évalué la valeur pronostique du volume total des plaques d’athérosclérose mesurée par scanner chez 3 711 patients avec maladie coronaire (ischémie moyenne à sévère ou obstruction coronaire) de l’étude ISCHEMIA. Les résultats montrent que le volume total des plaques est fortement associé au risque de décès cardiovasculaire ou d’infarctus du myocarde (HR = 1,56 ; p = 0,001). L’ajout de ce paramètre aux facteurs de risque cliniques a amélioré la capacité prédictive des événements cardiovasculaires à 6 mois, 2 ans et 4 ans (AUC passant de 0,608 à 0,654 ; p = 0,002). Même si cette augmentation est modeste, cela pourrait affiner la stratification du risque dans les populations à haut risque cardiovasculaire(1).
Maladie coronarienne et association à une cardiomyopathie ischémique ou non ischémique
Dans cette étude publiée dans Circulation, les auteurs analysent la prévalence et l’impact pronostique d’une cardiomyopathie associée chez 3 023 patients atteints de maladie coronarienne obstructive. En IRM cardiaque avec rehaussement tardif au gadolinium, 16,9 % des patients présentaient une cardiomyopathie (9,3 % une cardiomyopathie non ischémique et 7,7 % une cardiomyopathie mixte, ischémique et non ischémique) alors que 64,8 % présentaient une cardiopathie ischémique et 18,2 % aucune cardiomyopathie. Un suivi médian de 4,8 ans a montré que les patients avec cardiomyopathie associée avaient un risque accru de décès toutes causes confondues ou d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque (HR = 1,23 ; p = 0,007). Ces résultats encouragent une meilleure identification des formes mixtes par l’IRM pour optimiser le traitement des patients(2).
Échocardiographie d’effort et fonction ventriculaire gauche
L’étude de Fazzini et coll. a évalué les caractéristiques cliniques et implications pronostiques d’une baisse paradoxale de la FEVG à l’effort chez des patients sans maladie coronarienne obstructive. Parmi 213 643 échocardiographies d’effort réalisées entre 2003 et 2022, 134 patients ont été identifiés avec une FEVG ≥ 50 % au repos, mais une diminution ≥ 5 % à l’effort, atteignant un seuil < 50 %. Ces patients, majoritairement des femmes (76 %), présentaient une incidence accrue d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque (17,6 % à 10 ans) et de fibrillation atriale (23,4 % à 10 ans). La mortalité globale était de 12,9 %, principalement liée à des causes non cardiovasculaires. Les mécanismes physiopathologiques de cette réponse anormale à l’effort ne sont pas élucidés, mais l’échocardiographie d’effort pourrait faire partie du bilan chez les patients présentant une dyspnée inexpliquée(3).
Consensus de l’European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) sur l’utilisation de l’échocardiographie de stress dans les syndromes coronariens chroniques et autres pathologies cardiovasculaires
Ce document introduit le protocole ABCDE, combinant l’analyse des anomalies de la cinétique segmentaire, de la perfusion myocardique, de la fonction diastolique et de la réserve contractile pour une stratification plus complète du risque cardiovasculaire. Un incontournable pour ceux qui pratiquent l’échocardiographie de stress(4) !
Nouvelles valeurs seuils pour la fonction ventriculaire droite
Zornitzki et coll. se sont intéressés à la réévaluation des seuils anormaux de la fonction ventriculaire droite en échocardiographie, en les corrélant à la mortalité chez 24 717 patients. En effet, les seuils actuels (< 17 mm pour TAPSE et < 9,5 cm/s pour S’) sont dérivés de populations saines, mais cette étude démontre que des valeurs plus élevées (< 20,9 mm pour TAPSE et < 10,9 cm/s pour S’) sont associées à une surmortalité. Chez les patients avec insuffisance tricuspide (IT) moyenne à sévère, les seuils de TAPSE et S’étaient plus bas (TAPSE < 18 mm, S’ < 10 cm/s). Ces résultats suggèrent que l’interprétation des indices échographiques de la fonction ventriculaire droite devrait évoluer avec des seuils de dysfonction ventriculaire droite plus élevés et que la présence d’une IT significative doit être prise en compte(5).
L’épargne apicale dans l’amylose cardiaque
Le diagnostic d’amylose cardiaque (AC) est suspecté devant la présence de « drapeaux rouges » lors de l’évaluation clinique, électrique et échographique. Un de ces drapeaux est le profil d’épargne apicale. Cette étude explore l’intérêt du ratio d’épargne apicale (ASR), qui correspond au rapport entre le strain longitudinal apical et non apical, en comparant 544 patients atteints d’AC (375 ATTR, 169 AL) à 200 té - moins ayant des caractéristiques cliniques similaires, mais sans amylose confirmée, ainsi qu’à 174 sujets sains. L’ASR était significativement plus élevé chez les patients AC (2,4 ± 1,2) par rapport aux témoins (1,7 ± 0,9 ; p < 0,0005), mais l’étude souligne une sensibilité modérée (72 %) et une spécificité limitée (66 %) pour discriminer les patients AC. De plus, un tiers des témoins et même 1/10e des sujets sains présentaient un ASR élevé, remettant en question son utilisation comme critère diagnostique spécifique pour l’identification des patients avec AC. Une approche multimodale combinant ASR avec d’autres paramètres échographiques, doit donc être utilisée(6).
Rôle du scanner dans l’amylose cardiaque
Cette étude a évalué l’apport du volume extracellulaire myocardique dérivé du scanner (CT-ECV) pour différencier la sténose aortique isolée (AS), l’amylose cardiaque transthyrétine isolée (lone ATTR) et la pathologie mixte (AS-ATTR). Parmi 138 patients inclus (55 AS, 19 AS-ATTR, 64 lone ATTR), le CT-ECV moyen était de 31 ± 5 % pour l’AS, 45 ± 12 % pour l’AS-ATTR et 53 ± 13 % pour l’ATTR isolé (p = 0,04). Les seuils optimaux de CT-ECV étaient 36,6 % pour différencier l’AS de l’AS-ATTR (Sen 84 % ; Spe 91 %) et 38,5 % pour distinguer l’AS de l’ATTR isolé (Sen 88 % ; Spe 98 %). L’étude souligne l’intérêt du CT-ECV dans la détection précoce de l’amylose cardiaque, ce qui pourrait être pertinent chez les patients bénéficiant d’un scanner dans le cadre d’un bilan pré-TAVI(7).
Modifications de la structure ventriculaire dans la cardiomyopathie hypertrophique (CMH)
Cette étude, issue de la sous-analyse CMR de l’essai SEQUOIA-HCM, a évalué l’impact de l’aficamten, un inhibiteur de la myosine cardiaque, sur le remodelage ventriculaire chez les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Parmi 282 patients randomisés, 57 ont participé à l’analyse par IRM cardiaque avant et après 24 semaines de traitement. Par rapport au placebo, l’aficamten a entraîné une réduction significative de la masse ventriculaire gauche (-15 g/m2, p = 0,001), de l’épaisseur pariétale maximale (-2,1 mm, p < 0,001) et du volume auriculaire gauche indexé (-13 ml/m2, p < 0,001). Le traitement a également réduit le temps de relaxation T1 natif myocardique (-37 ms, p = 0,026), suggérant une diminution du stress myocardique, bien que la fibrose myocardique (LGE) et le volume extracellulaire (ECV) soient restés inchangés. Ces résultats suggèrent que l’aficamten pourrait induire un remodelage bénéfique, susceptible de réduire les événements cardiovasculaires à long terme, notamment l’insuffisance cardiaque et la fibrillation auriculaire(8).
Risque arythmique et imagerie cardiovasculaire
Cette étude multicentrique a comparé les caractéristiques de la cardiomyopathie dilatée (DCM) et de la cardiomyopathie ventriculaire gauche non dilatée (NDLVC) en utilisant l’IRM cardiaque et des tests génétiques. Parmi 462 patients analysés (227 DCM, 235 NDLVC), les patients NDLVC présentaient une meilleure fonction systolique (FEVG moyenne : 51 % vs 36 % dans DCM, p < 0,001) et une plus forte prévalence de mutations dans les gènes arythmogènes (40 % vs 23 %, p < 0,001). L’analyse du rehaussement tardif au gadolinium (LGE) a révélé que le LGE septal était plus fréquent dans la DCM (45 % vs 32 %, p = 0,004), tandis que le LGE de la paroi libre était plus fréquent dans la NDLVC (27 % vs 14 %, p < 0,001). Sur un suivi médian de 81 mois, le LGE septal était un facteur indépendant de risque accru de mort subite ou d’arythmies ventriculaires majeures (HR = 1,93, p = 0,039). Cette étude met en évidence l’importance de l’IRM cardiaque pour la stratification du risque arythmique(9).
Ratio accélération-temps d’éjection dans la sténose aortique
Cette étude a exploré le rapport temps d’accélération/temps d’éjec tion (AT/ET) dans la prédiction du pronostic et la sélection des patients pour le remplacement valvulaire aortique (RVAo) en cas de sténose aortique paradoxale à bas débit et bas gradient. Parmi 171 patients suivis sur une médiane de 8,9 ans, un AT/ET ≥ 0,35 était un prédicteur indépendant du critère composite de mortalité cardiaque ou de RVAo (HR : 4,77 ; p < 0,001), avec une valeur ajoutée aux indices standards de sévérité. Le RVAo dans ce groupe était associé à une réduction significative de la mortalité cardiaque à 5 ans (HR : 0,09 ; p < 0,001). En revanche, aucun bénéfice du RVAo n’a été observé chez les patients avec AT/ET < 0,35, suggérant que ce paramètre simple de réalisation pourrait guider la sélection des patients pour une intervention valvulaire dans cette population hétérogène(10).
EN PRATIQUE
• L’imagerie cardiovasculaire en 2024 se positionne comme un levier essentiel pour un diagnostic plus précoce, et une évaluation plus fine du risque pour personnaliser les traitements, améliorant ainsi le pronostic des patients.
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :